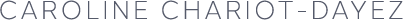Plis mystiques d’hier et d’aujourd’hui
Par Rémy Vallejo, Lumières du Nord, Éditions du Centre Les Dominicains, 2023
Peindre me procure un sentiment de transcendance
Par Michel Paquot, L’Appel, octobre 2023 (cliquer ici)
L’Art est le témoin de la beauté
Par Jean-Baptiste Ghins, avec Jean-Paul Dessy, En Question : Qu’espère-t-on encore de la culture, hiver 2023 (cliquer ici)
Le chant sacré des Étoffes
Par Gwennaëlle Gribaumont, La Libre Belgique, août 2023 (cliquer ici)
Je vis la peinture comme une expérience spirituelle
Par Tania Markovic, RTBF, août 2023 (cliquer ici)
À la Cathédrale, l’invisible se donne à voir
Par Bosco d’Otreppe, La Libre Belgique, juin 2021 (cliquer ici)
Plis de l’Invisible
Par Corinne Owen, Dimanche, mai 2021
Plooien van het Onzienbare
Par Johan Van der Vloet, MagaZijn, mai 2021
Et si le mystère du sacré se cachait dans les plis ?
Par Louise Alméras, Aleteia, mai 2019 (cliquer ici)
Plis de l’esprit
Par Jean Deuzèmes, Voir & Dire, 2016 (cliquer ici)
L’Invisible, l’autre face du réel
Les cahiers Croire, n°305, Bayard, Paris, 2016
Brûlants-au-dedans : Polyptyque de Caroline Chariot-Dayez
Par Alain Arnould o.p., RiveDieu, n°15, janv-fév 2013
Artiste au Prieuré : Caroline Chariot-Dayez
Le Prieuré de Malèves-Sainte-Marie, 2012 (cliquer ici)
Plis et replis
Pratique des arts, n°71, nov-janv 2007
Monographie – Caroline Chariot-Dayez
Edition Art in Belgium, Lasne, 2005